Audit sur le traitement de l’insuffisance rénale chronique terminale

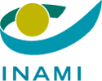
1 Résumé exécutif
Cet audit se concentre sur le traitement par dialyse des patients adultes souffrant d’insuffisance rénale chronique terminale. Dans ce cadre, on s’est surtout penché sur la mesure dans laquelle la politique des autorités a facilité l’évolution vers des soins davantage centrés sur le patient (depuis le rapport 124 du KCE de 2010) et sur la mesure dans laquelle on applique les directives internationales en matière de soins de dialyse publiquement disponibles.
Pratique actuelle des soins de dialyse en Belgique.
Comme ailleurs, en Belgique, la pratique actuelle en matière de soins de dialyse est dominée par le traitement par hémodialyse classique à l’hôpital ou dans un centre d’autodialyse collective (CAD), généralement situé dans un hôpital. Cela fait déjà plusieurs années que le nombre de patients qui suivent une dialyse à domicile reste pratiquement inchangé. Dans le cadre des audits menés sur place, nous avons constaté qu’1 centre de dialyse agréé sur 6 ne proposait pas directement de dialyse péritonéale. Il s’agit pourtant d’un élément essentiel des normes d’agrément légales d’un centre (AR du 27 novembre 1996). Le nombre de transplantations est déjà très élevé, mais par rapport aux Pays-Bas, si les dons vivants atteignaient un niveau similaire à celui des Pays-Bas, il pourrait encore augmenter.
Dans quelle mesure la politique a-t-elle facilité l’évolution vers des soins davantage centrés sur le patient ?
Depuis le rapport 2010 du KCE, l’autorité a pris plusieurs initiatives pour encourager l’évolution vers des soins davantage centrés sur le patient. Dans ce cadre, la convention INAMI de 2016 a été la plus importante. Cela a conduit à un plus grand nombre de patients dans les CAD (centres d’autodialyse collective) (comme forme de dialyse « low care »), une situation plus avantageuse au niveau du budget. Par contre, cela n’a pas conduit à des soins davantage centrés sur le patient, dans le cadre desquels les patients peuvent librement choisir entre toutes les formes de dialyse médicalement possibles dans leur cas et cela, sur la base d’une information de qualité. Un élément important pour y parvenir est un trajet de prédialyse bien élaboré, documenté et mis en œuvre. Ce trajet n’est cependant défini ni par son mode d’organisation ni par son contenu. Si la majorité des centres disposaient bien de plusieurs éléments d’un trajet de ce type, il leur manquait souvent un processus standardisé d’évaluation de la qualité de vie et du pronostic ainsi qu’un plan de soins.
Dans quelle mesure les recommandations publiquement disponibles ont-elles été appliquées ?
Notre pays manque de directives (inter)nationales sur les soins de dialyse faisant autorité et reconnues comme telles par les associations professionnelles et/ou l’autorité. Il s’agissait pourtant d’une des principales recommandations du rapport du KCE. La plupart des aspects des soins audités étaient toutefois conformes aux principales recommandations internationales (KDIGO). D’importantes exceptions dans certains centres nuancent toutefois ce constat ; par exemple, certains centres ne proposaient pas de fistule AV, pas de diététicien, pas de registre des complications ou de cycle d’amélioration, pas d’offre de dialyse péritonéale et pas d’offre d’hémodialyse à domicile.
Trente recommandations ont été formulées pour améliorer la qualité et l’efficacité des soins.